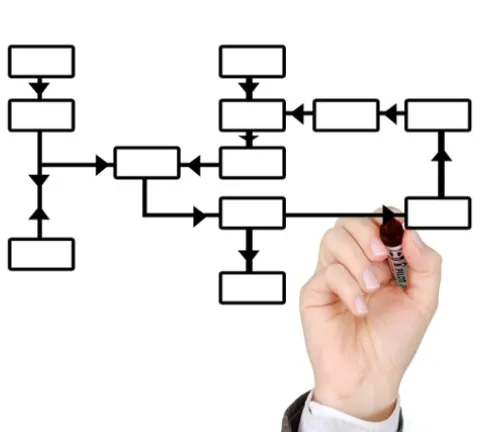Guerre de l’information au Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) entre la Russie et la France (2020 – 2024)
Entre 2020 et 2024, la région sahélienne, précisément le Burkina Faso, le Mali et le Niger, est devenue le théâtre d’un affrontement informationnel intense opposant deux puissances grandes : la France, enracinée depuis la période coloniale, et la Russie, nouvel acteur offensif dans la région. C’est dans un contexte de crise sécuritaire, de montée du sentiment anti-occidental, et de transition politique chaotique, que ces deux puissances s’affrontent par une guerre d’information virulente et très agressive. Une véritable hybridation de la guerre conventionnelle.
La France grâce à son héritage colonial et ses alliances militaires (opérations Serval, Barkhane, Takuba…), tente de défendre sa légitimité par des actions humanitaires, des coopérations locales et une communication diplomatique institutionnelle. Elle veut conserver son statut de partenaire stratégique et historique.
Face à elle, la Russie mène une stratégie offensive fondée sur une diplomatie d’influence, appuyée par des médias alternatifs, des réseaux sociaux, des figures panafricanistes, et l’engagement de sociétés militaires privées. Moscou critique ouvertement l’intervention occidentale et propose une nouvelle lecture des enjeux sécuritaires, séduisant une opinion publique locale de plus en plus hostile à la France.
À travers des campagnes de désinformation, de narration concurrente et des alliances symboliques, la guerre de l’information au Sahel devient un outil de recomposition géopolitique.
Ce phénomène pose la problématique suivante : Comment la guerre de l’information menée par la Russie au Sahel a-t-elle contribué à l’érosion de la souveraineté diplomatique, politique et économique de la France dans cette région ?
Cet article, fondé sur la méthodologie de l’EGE, propose une analyse stratégique de cette confrontation asymétrique d’influence, en s’appuyant sur les dynamiques historiques, les dispositifs d’influence déployés, les réponses françaises, et les conséquences observées sur les opinions publiques et les rapports diplomatiques.
Arthur Nkili (MSIE 47 de l’EGE)
Télécharger le PDF :