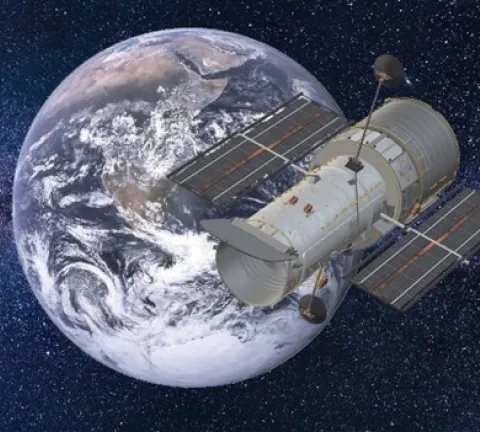Satellites en orbite basse : l’Europe en retard dans la guerre informationnelle du XXIe siècle.
Alors que les tensions internationales se multiplient et que les conflits armés s’intensifient, une nouvelle dimension critique du pouvoir géopolitique s’impose : le contrôle de l’espace proche, et en particulier, des satellites en orbite basse. Ces constellations, longtemps perçues comme de simples infrastructures techniques de télécommunications, se révèlent désormais être des leviers décisifs dans la conduite des guerres hybrides, dans la maîtrise de l’information, et dans la préservation de la souveraineté numérique des États. L’Europe, prise dans une forme de dépendance technologique croissante, peine à suivre la cadence imposée par les géants américains du spatial privé. Ce retard stratégique soulève aujourd’hui des inquiétudes majeures.
Dans les théâtres d’opération modernes, les satellites LEO (Low Earth Orbit) ont démontré leur utilité militaire directe. Le cas ukrainien reste l’exemple le plus emblématique de cette mutation. Dès les premiers jours de l’invasion russe, la constellation Starlink, développée par SpaceX, a permis aux forces armées ukrainiennes de maintenir une connectivité fiable malgré les bombardements, les sabotages d’infrastructures et les tentatives de brouillage numérique. Grâce à leur faible latence, leur mobilité, et leur résilience, les satellites LEO et leurs récepteurs sans fils ont permis la transmission sécurisée des ordres, la navigation de drones armés, la coordination interarmes et la continuité des communications entre centres de commandement. Ce que l’on pensait être une infrastructure d’appoint s’est imposée comme un élément central de la guerre moderne. Et ce n’est pas uniquement la technologie brute qui impressionne, c’est aussi la manière dont elle peut devenir un outil de pression diplomatique.
Le contrôle de l’activation de ces constellations, ou au contraire leur désactivation ciblée, est rapidement apparu comme un levier de pouvoir. Ce sont désormais des instruments qui peuvent faire basculer un front, renforcer ou affaiblir un régime, ou encore influer sur des négociations diplomatiques. Ces outils sont devenus une nouvelle forme de guerre informationnelle et à ce titre, ils doivent être considérés à égalité avec les autres outils de souveraineté nationaux : l’arsenal nucléaire, les approvisionnements en matières premières critiques, ou encore les réseaux énergétiques. Et pourtant, l’Union européenne semble en grande partie spectatrice de cette évolution.
À des altitudes comprises entre 300 et 1 500 kilomètres, des milliers de satellites sillonnent aujourd’hui l’orbite terrestre, créant un maillage numérique inédit. Ce maillage
est censé garantir une couverture internet globale, mais il devient aussi un système de surveillance, d’interception, et de diffusion de données critiques. La logique commerciale qui a mené à leur développement a progressivement laissé place à une logique stratégique : contrôler le ciel proche, c’est contrôler les flux d’informations, les mouvements militaires, les communications diplomatiques, et jusqu’à la souveraineté décisionnelle des nations. Le débat sur la neutralité technologique de ces outils est désormais dépassé.
Le choix d’un opérateur de services satellitaires, notamment dans le secteur LEO, est devenu un acte hautement politique. Les critères classiques de performance (débit disponible, latence, taux de disponibilité, résistance aux brouillages) ne suffisent plus. Les acheteurs, qu’ils soient publics ou privés, militaires ou industriels, exigent aujourd’hui des garanties supplémentaires :
- Protection des données sensibles.
- Chiffrement de bout en bout.
- Cloisonnementdes flux.
- Indépendance vis-à-vis des puissances étrangères.
Un opérateur placé sous juridiction américaine ou chinoise peut être écarté d’un appel d’offres, non pour des raisons techniques, mais par précaution géopolitique. Dans cette nouvelle configuration, l’autonomie d’une infrastructure numérique devient une composante essentielle de la souveraineté nationale.
Derrière cette évolution se trouvent des acteurs à la puissance technologique sans précédent. Starlink (SpaceX) domine aujourd’hui le marché, avec plus de 7 000 satellites opérationnels. Son modèle repose sur la vente de terminaux à haute performance, des abonnements premium pour les zones supplémentaires couvertes, et des services spécialisés pour les gouvernements, les ONG, les marines marchandes, et les armées. Son architecture entièrement intégrée, allant du satellite au client final, lui confère une rapidité de déploiement, une sécurité opérationnelle, et une flexibilité que peu d’acteurs peuvent égaler. Amazon, via son projet Kuiper, entend suivre le même chemin. Avec un lancement prévu fin 2025, il proposera des débits allant jusqu’à 1 Gbps, couplés nativement aux infrastructures cloud d’AWS. OneWeb, intégré à Eutelsat, reste encore derrière en termes de couverture avec ses 600 satellites, mais sa fusion avec l’opérateur européen lui donne un rôle stratégique singulier.
Ci-dessous se trouve un tableau récapitulatif des principaux opérateurs de satellites en orbite basse, intégrant leur nationalité, structure capitalistique, levées de fonds, alliances stratégiques et nombre de satellites en orbite estimé en 2025. Ce panorama permet de mieux comprendre les rapports de force à l’œuvre dans la course à la connectivité orbitale et les dépendances politiques qui en découlent.
Opérateur | Nationalité | Actionnaires / Soutiens | Levées de fonds estimées | Partenaires stratégiques | Nombre de satellites en orbite (2025) |
Starlink (SpaceX) | États-Unis | Elon Musk (via SpaceX), fonds américains, soutien US DoD | +10 Mds $ | DoD, USAF, Ukraine, OTAN | +7000 |
OneWeb (Eutelsat) | France / Europe / Inde | État français, Bharti Global (Inde), CMA CGM, FSP | 1,35 Mds € | Ministères français, ESA, UE | 600 |
Amazon Kuiper | États-Unis | Amazon Inc. (Jeff Bezos), financement interne | 10 Mds $ | AWS,Blue Origin, Verizon | 0 (en déploiement) |
Telesat Lightspeed | Canada | Gouvernement canadien, Banquede développement, PSP Investments | 2 Mds$ CAD | ThalesAlenia Space | 0 (en pré- lancement) |
Iridium Communications | États-Unis | Boeing, Baird, soutiens militaires US | Inconnue | US Navy, Airbus | 80 |
SES mPower (Luxembourg) | Luxembourg | État luxembourgeois, fonds privés, partenariat Boeing | 1,3 Mds € | Boeing, Thales, EU GOV | 12 (prévus à 198) |
Tableau comparatif de l’offre
Face à ces avancées fulgurantes, l’Union européenne tarde à organiser sa riposte. Pourtant, les signaux d’alarme se multiplient. En février 2025, l’administration américaine a menacé de suspendre le service Starlink en Ukraine, en échange de concessions sur l’exploitation des ressources minières. Ce chantage à la connectivité a révélé au grand jour la dépendance critique de certains États à des services qu’ils ne contrôlent pas. L’Europe se retrouve ainsi dans une situation de vulnérabilité, incapable de garantir à ses armées, à ses institutions, ou à ses citoyens, une connectivité stratégique indépendante.
Le consortium Spacerise (SES, Eutelsat and Hispasat), via son projet européen IRIS² lancé en 2022, ambitionne de répondre à cette impasse. Prévu pour 2030, il doit constituer la première constellation souveraine européenne, compatible avec les standards de l’OTAN, sécurisée de bout en bout, et capable de couvrir l’ensemble du territoire européen et de ses partenaires stratégiques. Mais le chemin reste semé d’embûches. Le financement reste insuffisant, la coordination institutionnelle fragile, et la concurrence privée féroce. Les ambitions affichées par la Commission européenne nécessitent un sursaut politique, industriel et financier.
Eutelsat malgré cela, grâce à sa fusion avec OneWeb, s’impose aujourd’hui comme le pivot potentiel de cette souveraineté orbitale. Très récemment, l’opérateur annonce vouloir lever 1,35 milliard d’euros, avec le soutien de l’État français, du groupe Bharti, de CMA CGM et du Fonds Stratégique de Participations. Cette opération vise à renforcer la constellation existante, accélérer le déploiement des satellites, et soutenir le programme IRIS². Un contrat-cadre de dix ans avec les Forces armées françaises a d’ores et déjà été signé. Il symbolise une inflexion majeure dans la politique spatiale européenne : la prise de conscience que l’autonomie stratégique passe par la maîtrise de ses infrastructures orbitales.
La France pousse cette logique encore plus loin. Lors du Salon du Bourget 2025, le président de la République a proposé de déployer la solution européenne non seulement au sein de l’Union, mais aussi auprès de ses partenaires stratégiques notamment l’Inde, Brésil, Canada. L’objectif est clair : créer un axe de coopération technologique pour tous ceux qui refusent de dépendre des États-Unis ou de la Chine en matière de connectivité stratégique.
Cette volonté de bâtir une solution européenne portée en grande partie par la France se heurte toutefois à une réalité politique parfois omise, l’unité européenne ne signifie pas systématiquement alignement stratégique. Nous pouvons penser que plusieurs États membres, bien que conscients des enjeux de souveraineté numérique, manifesterons une réticence à s’engager dans une solution perçue comme trop centralisée autour des intérêts français. Certains précédents programmes de défense en sont une illustration criante. Ces dernières années, plusieurs pays européens, parmi lesquels l’Allemagne, la Belgique, ou la Pologne, ont préféré se doter de chasseurs américains F-35 plutôt que d’investir dans des appareils européens comme le Rafale. Ce choix, au-delà des aspects techniques ou budgétaires, reflète aussi une volonté diplomatique de maintenir des liens étroits avec les États-Unis, perçus comme garants ultimes de la sécurité en Europe via l’OTAN. Ce réflexe atlantiste pourrait se reproduire dans le domaine spatial, freinant l’émergence d’une constellation LEO souveraine made in Europe. Il souligne le dilemme fondamental auquel l’Union est confrontée : construire une autonomie stratégique réelle, sans renier les alliances existantes ni diviser les États membres sur des lignes d’influence géopolitiques.
Par ailleurs, la dimension juridique n’est pas secondaire, elle devra être au cœur même de la guerre informationnelle qui se jouera demain dans l’espace. Comme souvent, la technologie va plus vite que la réglementation et le vide normatif qui entoure actuellement l’exploitation des orbites basses crée un environnement propice à l’asymétrie stratégique, à la dépendance technologique, et à l’usage de la connectivité comme arme diplomatique. Dans ce contexte, l’émergence d’un droit spatial international renouvelé, et surtout d’un droit spatial international ambitieux, devient une condition sine qua non pour rééquilibrer les rapports de force.
Le cadre juridique actuel, notamment le Traité de l’espace de 1967, signé à l’ONU, interdit certes la militarisation de l’espace extra-atmosphérique, mais reste largement obsolète face à l’essor des constellations LEO commerciales à usages duals (civil et militaire). Rien n’interdit aujourd’hui à un opérateur privé, sous influence étatique, de couper ou de dégrader un service dans un contexte géopolitique tendu. C’est précisément ce qui a été observé en Ukraine, où la capacité d’accès au réseau satellitaire a été conditionnée par des décisions politiques étrangères. Autrement dit : le droit international actuel est incapable de protéger les États d’une instrumentalisation de la connectivité.
C’est pourquoi l’Europe doit impérativement devenir une puissance normative orbitale. Elle doit initier une refondation du droit spatial, fondée sur la transparence, la neutralité des services critiques, et la souveraineté des données. Cela impliquerait entre autres de réglementer les sujets majeurs suivants :
- Interruption unilatérale des services en cas de conflit.
- Divulgation des flux de données sensibles.
- Règles de souveraineté numérique extraterritoriale (sur le modèle du RGPD).
- Réglementation du brouillage.
Ce droit serait par ailleurs surement plus efficace à ne pas être seulement déclaratif. S’il pouvait être articulé à des moyens de contrôle techniques et à des instruments de rétorsion économique, par exemple en conditionnant l’accès au marché européen à la conformité réglementaire, celui-ci aurait un impact majeur.
Dans le contexte actuel, le droit spatial pourrait devenir une arme invisible de la guerre informationnelle. Celui qui définit les normes contrôle non seulement les règles du jeu, mais aussi l’architecture même de la bataille numérique. En prenant l’initiative sur ce terrain, l’Union européenne peut redéfinir un espace stratégique sécurisé, éthique et souverain. À défaut, elle restera dépendante de décisions juridiques extraterritoriales, souvent opaques, et orientées par des intérêts qui lui échappent.
Dès lors, il ne s’agit plus uniquement de construire une constellation souveraine, mais de reconquérir la capacité à définir ce qui est acceptable, légal et stratégique dans l’espace numérique orbital. L’Europe, en championne du droit et de la régulation dans le numérique terrestre, peut reproduire cette puissance d’influence dans l’espace extra- atmosphérique. Elle y jouera non seulement son autonomie, mais aussi sa crédibilité comme acteur de paix dans un monde fragmenté.
Luc-Arthur Adjou (MSIE 47 de l’EGE)